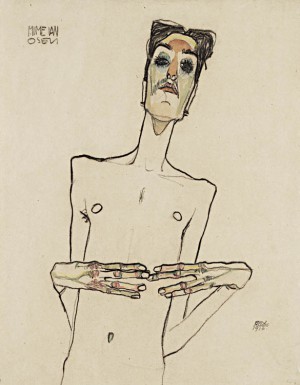Les télescopes sont aveuglés par la terreur de l’univers
Et la mort a bu
Les yeux fantastiques des astrologues
Jaroslav Seifert
Introduction praguoise
Depuis 1410, on peut voir, sur une façade de l’hôtel de ville de Prague, l’une des plus sublimes horloges astronomiques au monde. Outre les cadrans richement ouvragés, les quatre allégories représentées aux côtés du cadran supérieur, à chaque heure, la figure de la mort tend son sablier et tire sur sa corde, les automates animés des douze apôtres à défiler au-dessus du cadran horaire. Une merveille de mécanique médiévale qui participe à l’image mystérieuse de la cité.
A la fin du XVIe siècle, l’empereur Rodolphe II fait de Prague sa capitale. Il appelle à ses côtés savants, artistes et mages des quatre coins de l’Europe et devient patron de certains alchimistes. La légende veut que l’Empereur, intéressé par le sciences et la magie, soit en quête d’une illumination. D’autres, dont l’écrivain Léo Perutz dans son chef-d’œuvre LA NUIT SOUS LE PONT DE PIERRE, présente ces motivations sous un angle plus contrasté : quête de pouvoir autant que mélancolie chronique. D’autres enfin en font une lecture très pragmatique, dépouillée de toute spiritualité : le processus de transformation alchimique permettrait, si seulement on pouvait l’accomplir, de renflouer les caisses bien vides du Prince, obligé de faire appel à des usuriers pour entretenir son train de vie – le plus célèbre, ayant lui aussi laissé trace dans la littérature, est Mordechai Maisel, le juif le plus riche de Prague. Perutz, dans son roman, emprunt de symbolique et de romantisme, avance également que la femme de Maisel et l’empereur entretenaient une liaison par rêves interposés, sans jamais s’être rencontrés, et que cette liaison prenait la forme d’un lys et d’une rose entortillant leurs tiges au bord de la Vlatva, sous le pont Charles qui relie le château à la vieille ville de Prague.
Cette époque est un creuset de legendes et d’histoires. On trouve alors à Prague le peintre Arcimboldo, célèbre pour ses portraits de notables en légumes ; le rabbin Löw, créateur du Golem (Elie Wiesel lui consacré notamment son roman LE GOLEM) ; le jeune Wallenstein y commence sa carrière d’officier (Perutz en parle dans une flamboyante nouvelle, mais c’est Alfred Döblin qui prendra ce personnage comme sujet d’un grand roman) le mage anglais John Dee (qu’on disait amant de la reine Elisabeth, avant qu’elle ne lui retire ses faveurs et ne l’exile) et son apprenti Edward Kelley, portraiturés par Gustav Meyrink dans L’ANGE A LA FENETRE D’OCCIDENT.
Enfin, et j’en arrive à ceux qui nous intéressent en premier lieu :l’astronome danois Tycho Brahé et son apprenti Johannes Kepler. Du deuxième on a retenu son apport majeur à l’astronomie : les trois lois qui portent son nom, et qui conduiront Newton à la formulation des lois de la gravitation.
Si tous les noms que j’ai cité ont laissé une trace scientifique ou littéraire, de Tycho Brahé en revanche, je savais peu de choses par les romans ou les études. Il apparaissait tout au plus comme un personnage de second ordre, marquant certes, de par sa prothèse nasale en or. On croise aussi quelques références à l’astronome dans les travaux d’Enki Bilal (son deuxième film notamment, TYCHO MOON), mais là encore, on reste dans l’évocation brève.
Brahé donne enfin son origine à une expression typiquement pragoise : « Je ne veux pas finir comme Tycho Brahé », prononcé lorsque, la bière faisant son effet, on doit se rendre aux toilettes en urgence ; la vie l’astronome danois aurait connu une conclusion funeste suite à l’explosion de sa vessie, de s’être trop retenu lors d’un banquet… c’est du moins ce qu’affirme la légende
Pourquoi cette longue introduction ? Sans doute pour expliquer pourquoi, dès l’annonce de publication du nouveau roman de Nicolas Cavaillès, une furieuse envie de le lire s’est emparée de moi.
Sans doute également parce que ce terreau d’histoires et de légendes est fascinant, participe de la construction de mon imaginaire, et que l’on ne parle pas très souvent des textes que je viens de citer (lisez-les !).
Peut-être également parce que la lecture du TEMPS DE TYCHO m’a énormément touché, et que, très égoïstement, faire des articles à rallonge me permet de rester un peu encore dans l’écriture de Cavaillès.
On verra bien où tout ça mène et combien d’articles ca prendra… et la prochaine fois, on parlera d’astronomie et j’en dirais un peu plus sur le personnage central de ce formidable travail d’écriture.
L’Homme au nez d’or
J’évoquais ci-dessus l’environnement pragois dans lequel évolua Brahé à la fin de sa vie et son côté fascinant mais, au-delà de la ville, l’époque et le personnage en eux-mêmes sont source d’émerveillement.
D’un point de vue cosmétique tout d’abord, puisque Brahé possède un physique frappant. Suite à un duel de jeunesse, il perd le bout de son nez et utilisera sa vie durant une prothèse en or. La légende praguoise fait souvent référence à lui comme « l’homme au nez d’or ». Cavaillès tiré de cette particularité physiques quelques belles pages, sans doute celles où transparaît le plus l’humanité du personnage le plaçant quelque-part entre grotesque et apitoiement, coquetterie vouée à l’échec et fierté affirmée. Malgré cette particularité physique qui contribua à le faire rentrer dans l’histoire, dans aucune représentation picturale de Brahé, le nez d’or ne pointe.
Brahé naît à la fin du XVIe siècle et meurt la première année du XVIIe siècle. En Occident, cette articulation entre deux siècles voit la conception que l’on se fait du monde évoluer. Alors qu’au siècle précédent, c’est l’invention de l’Amérique le début des explorations qui bouleversent le monde, l’époque de Brahe voit advenir une autre révolution, celle de l’astronomie avec les travaux de Copernic et la description de son système héliocentrique.
C’est aussi une période de changement pour les scientifiques qui progressivement s’affranchissent de l’Eglise, à leurs risques et périls, et développent des méthodes scientifiques, même si celles-ci s’accommodent encore assez bien de croyances et de pseudo-sciences comme l’Alchimie ou l’Astrologie.
En ce sens, Tycho est le pur produit de son époque de transition et cela contribue à rendre sa figure fascinante. Ayant étudié les modèles copernicienne, il finit par en rejeter une partie pour proposer un modèle hybride, réconciliant – ou combinant – les systèmes de Ptolemée et de Copernic. Chez Brahé, les planètes tournent bien autour du soleil, mais celui-ci continue, tout comme la lune, de tourner autour de la Terre, point central de l’univers. Et autour, les étoiles disposées sur le bord lointain du système. Le système de Tycho ne s’imposera jamais, son élève le plus prometteur, Johannes Kepler, se ralliera finalement aux théorie coperniciennes ; Galilée parachèvera le travail.
Mais ce modèle est fascinant en ce qu’il tente de faire une synthèse entre anciennes et nouvelles conceptions de l’univers.
De la même manière, alors que Brahé innove en procédant à des observations très précises de la course des astres, en utilisant des horloges et en calculant (ou du moins en tentant de le faire) à la seconde près les périodes, il ne se détache toutefois pas de préceptes astrologiques.
Là encore, Cavaillès tire des pages magnifiques de l’obsession et des travaux de Brahé, de ce que laisse suggérer cette conception hybride de l’univers… et de la fierté que le personnage en tire. C’est l’une des choses que j’apprécie le plus dans l’écriture de Cavaillès, et qui rappellera d’heureux souvenirs à celles et ceux qui ont aimé POURQUOI LE SAUT DES BALEINES (publié aux excellentes Éditions du Sonneur ): faire de la science et les théorie scientifique un terreau de rêverie, un moteur à l’imagination, une inspiration à des divagations philosophiques aussi fascinantes que profondes. Une manière de susciter l’émerveillement…
Le château sous les étoiles
Je vous ai infligé une longue introduction praguoise pour vous parler de ce livre, mais pourtant, la capitale de Rodolphe II apparaît de manière très succincte dans le livre de Cavaillès. Les dernières années de Brahé sont évoquées par un long témoignage de Kepler, venu comme s’excuser d’avoir abandonné les théories de son maître.
Tout aussi fascinant est le décor que compose l’observatoire d’Uraniborg « la cité des cieux », que Brahé fait construire sur l’île de Hven, et dans lequel il résidera 20 ans. C’est assez jeune que l’astronome obtient l’autorisation et un montant d’argent conséquent de la part du roi du Danemark pour bâtir loin de toute ville cet observatoire modèle. Il en réalise le plan et les aménagements, puis s’y retire, entouré de sa nombreuse famille et de ses étudiants. Cavaillès y consacre là encore de belles pages durant les deux premiers chapitres, mêlant les obsessions de Brahé et le caractère fantastique du lieu. Dès l’évocation de la construction, le bâtiment s’impose comme une sorte de Poudlard de l’astronomie :
Sous la férule du jeune savant, tout juste trentenaire, l’île devait se suffire elle-même, comme un monastère : consacrée a l’élevage, à l’agriculture, et surtout à l’astronomie, elle abriterait aussi une papeterie, une imprimerie, un laboratoire d’alchimie, une prison et bientôt un second observatoire, souterrain celui-ci, baptisé Stjerneborg, tandis que les salles, tourelles et terrasses d’Uraniborg, ses plateformes secrètes, ses dômes pyramidaux, ses arches dynamiques et ses balustrades octogonales formeraient le meilleur écrin possible aux instruments de mesure, aux globes et aux machines du maître des lieux, comme à la cour d’astronomes, de notables et d’aristocrates qui assistèrent à ses nuits de travail et à ses banquets pantagruéliques.
Folie architecturale dédiée au seul pouvoir de son maître, Uraniborg et sa cour font presque figure de concurrents au palais et à la cour danoise, à tel point que même la reine aime à fréquenter ces murs. Mais Brahé ne se satisfait pas d’une domination temporelle, c’est l’Univers qu’il entend régenter, et la bâtisse est un écrin à sa mégalomanie.

Plus tard encore, Cavaillès évoque, le temps de trois battements de pendule, la grande salle des cadrans… mais dans cet endroit nous y reviendrons demain car, tout comme il constitue le cœur d’Uraniborg, il est le cœur du roman.
Le deuxième chapitre du Temps de Tycho se déploie, longue et riche description de la cour de l’astronome. Uraniborg y apparaît comme le sujet d’une de ces miniatures foisonnantes de détails, où chaque fenêtre est prétexte à une petite saynète. Cavaillès explore les recoins d’une salle pleine de monde, durant l’un des exposés du maître – ou un banquet ? S’attarde sur chaque personnage, individuellement ou en groupe, puis s’évade progressivement de la pièce, puis du château, puis de l’île, jusqu’aux étoiles. Une virtuosité d’écriture qui me laisserait à penser qu’un tableau a soutenu la description de l’écrivain, dans un exercice qui se rapprocherait des ONZE de Pierre Michon. Mais en fouinant sur Internet, rien qui ressemble à ce que l’auteur dit, si ce n’est une belle gravure coloriée à l’ambiance proche.

Le roi du Danemark, généreux protecteur de l’astronome finira par mourir, et son successeur n’aura pas la même passion pour les astres. Quelques années plus tard, Brahé, dont la cour s’est réduite à peau de chagrin, devra partir.
La fin du roman voit un mystérieux voyageur arpenter les ruines d’Uraniborg. Tout comme le modèle de Brahé, son château n’aura guère survécu à son concepteur, et celui qui rêvait de percer les mystères de l’univers, ici aussi, n’aura laissé pour postérité, que quelques histoires fabuleuses, quelques gravures propices à la rêverie.
Mesurer l’Univers
Si le système géo-heliocentrique de Tycho Brahé était une impasse, ce n’est pas ici que réside l’apport fondamental de l’astronome à sa matière. L’immense avancée qu’il propose réside surtout dans la manière de mesurer les mouvements des astres avec une grande précision par l’usage de machines modernes, et notamment des horloges ; elles lui permettent, plus ou moins fiablement, de réaliser des observations à la seconde près.
On trouve ici un autre de mes points de fascination personnels : la fascination devant les premiers instruments de mesure que l’on trouve notamment en vitrine au musée des arts et métiers. Astrolabes, boussoles, télescopes en cuivre, délicatement ouvragés… et horloges. Et puis diagrammes, tables et schémas couchés sur le papier, tracés ésotériques que le profane peut néanmoins admirer pour leurs qualités esthétiques, pour ce qu’ils suggèrent de la manière dont, à une époque, on se représentait le monde.
La volonté de dominer le temps est le point central du texte de Cavaillès. Apparaissant dès le titre, évidemment, il fournit à l’auteur le cœur de ses songeries sur l’astronome, ce qui stimule son imagination jusqu’à dépasser le sujet même.
Là encore, en prenant l’écriture à sa surface, ces ruminations spirituelles fournissent quelques paragraphes magnifiques, quelques pages sublimes soulignant le désir mégalo de contrôle qui anime Tycho :
Astronome a plusieurs titres monstrueux, il employa sa vie à relever des données spatio-temporelle et, ce faisant, il condamna les autres à l’obsession funèbre d’un écoulement détaillé, ciselé, du temps ; alchimiste et mécanicien, il s’echina en effet, le premier dans l’histoire de l’humanité, à faire retentir le balancier d’une trotteuse : d’abord, tic, dans les silencieuse salle des cadrans d’Uraniborg, tac, puis dans tout l’observatoire, tic, et sur l’ensemble de l’île, tac, depuis les eaux glaciales de la Scandinavie, tic, jusques aux confins de l’univers, tac, une trotteuse prodromique enclenchée au printemps de l’année mil cinq cent soixante-dix-sept et qui ne s’arrêta plus ensuite, indestructible et exponentielle.
Le désir fou de précision de Brahé serait le point de départ de l’encagement du temps, de sa circonscription par la mesure, l’emprisonnement bercé par le rythme du balancier.
Mais c’est aussi l’impuissance de Tycho qui est parfois palpable, notamment dans un passage quelques pages plus loin, celui de l’impossible précision, alors que l’auteur décrit la lutte de l’astronome en quête de la mesure régulière, avec deux horloges qui, chacune à son tour, se dérèglent et qu’il faut surveiller en permanence, réajuster et, lorsque le décalage est trop important, poussent l’astronome à retourner aux estimations au doigt mouillé pour effectuer ses notations.

La mesure du temps est ici une grande avancée et la naissance d’un Mal ; l’obsession d’un homme devenant une règle collective.
Avec les années, si l’obsession reste, les moyens de Tycho se délitent. Privé de son observatoire parfait, il ne pourra pas fonder une deuxième fois un lieu adapté a ses lubies, malgré l’argent de l’empereur. Il n’en a plus la force.
Le temps, on l’a dit, ne sera pas un ami généreux pour Tycho, il aura tôt fait d’user son serviteur, puis de précipiter son œuvre dans l’oubli, observatoires, tables et systèmes. Rien ne reste d’Uraniborg. Rien ne reste de son système, à peine une stèle rend hommage à l’homme dans l’église de Notre Dame de Týn… et une légende de bistrot praguoise.
Caché au cœur de nos montres, de nos agendas, de nos deadlines et de nos horaires de transport, peut-on encore percevoir parfois le bruit de la trotteuse de Tycho ?
Le maître horloger
J’en ai déjà dit beaucoup sur Le Temps de Tycho, mais je me suis maintenu très en surface du texte. Comme je l’évoquait lors de la première partie de cette (trop) longue note de lecture, la vie de Tycho est aussi le moyen que Cavaillès use pour aborder la vie et la temps de manière philosophique. J’aurais pu aussi parler de la mystérieuse relation liant Brahé et Shakespeare, mais il fait bien vous préserver quelques surprises si vous vous décidez à attaquer ce livre.
J’ai commencé cette chronique en parlant de l’horloge astronomique de Prague, quand bien même elle ne figure dans le texte. Il ne s’agissait pas que d’un prétexte a élucubration, mais plutôt d’une image de ce que pourrait être ce texte : une horloge délicatement ouvragée, et quitte à sombrer dansles métaphores un peu faciles dont on aime à parsemer nos avis culturels, je proposerais bien celle qui décrit l’auteur comme maître horloger.
Car au-delà du sujet, ce qui m’attire dans l’écriture de Cavaillès, c’est son incroyable précision, que l’on retrouve livre après livre. Un art et une érudition du mot qui lui fait (presque) toujours choisir le mot le plus juste, non dans un soucis d’étaler sa science du vocabulaire, mais pour dire ce qui est. De cet assemblage de micro rouages, il tire des romans et des courts, très concentrés, qui disent beaucoup à l’économie, qui se déploient selon un rythme savamment composé. C’etait sensible, je crois, dans l’extrait choisi pour illustrer la partie 4 de cette chronique.
Mais c’est une constante chez Cavaillès, qu’il restitue le pas de l’âne qui descend la montagne (Dans LE MORT SUR L’ÂNE, aux éditions du Sonneur ), les doigts qui courent sur le clavier pour dire l’effroyable dans la famille (LES HUIT ENFANTS SCHUMANN, au Sonneur encore), ou qu’il tente de trouver la raison provoquant le saut des baleines (POURQUOI LE SAUT DES BALEINES, livre incroyablement beau et étrange, lui aussi paru au Sonneur).
Précision, intelligence, rythme créent sous ses doigts des textes profonds, emprunts de rêveries et de réflexions acérées sur ce qui nous entoure. Une dissection musicale, historisue, biologique ou astronomique, qui ne donne pas de réponses definitives, mais ouvre des pistes au lecteur pour, au gré de sa rêverie, de ses réflexions propres, ouvrir une voie, très intellectuelle, certes, mais sans pose, sans prétention, vers le merveilleux qui nous entoure.
Bref, Nicolas Cavaillès (par ailleurs brillant traducteur du roumain), est un formidable écrivain. Et si vous avez tenu jusqu’ici, et si vous n’avez lu de lui que ce seul TEMPS DE TYCHO, je vous invite à découvrir le reste de sa littérature de précision chez ses autres éditeurs : les éditions du Sonneur, Black Herald Press et Marguerite Waknine !
Nicolas Cavaillès, Le Temps de Tycho, éditions José Corti, 2021